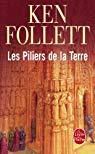Avril 2019,
L’homme qui aimait les chiens ! Un titre sans relief, pas vraiment attractif, qui aurait pu me faire passer à côté d’un livre époustouflant : un épais roman historique de sept cent cinquante pages portant sur des événements du vingtième siècle, accrochant comme un thriller, passionnant comme une biographie ; et instructif comme un commentaire politique, car certaines idéologies du vingtième siècle continuent à faire l’objet de débats aujourd’hui, bien que...
Que viennent faire les chiens là-dedans, demandez-vous ? Il y a bien, dans le roman, un personnage auquel le narrateur attribue le qualificatif d’homme qui aimait les chiens… Les autres personnages aimaient aussi les chiens... Parmi tous ces chiens, notons juste les barzoïs, des lévriers russes à poil long, qui furent les mascottes de l’aristocratie tsariste, avant d’accompagner, à leur tour, quelques hauts dignitaires soviétiques. Voilà qui nous permet de situer le cœur stratégique de l’intrigue.
Si c’est bien au Kremlin que l’on tire les ficelles, ce n’est pas à Moscou que se déroule l’essentiel de l’action. La trame romanesque se compose du meurtre annoncé d’un homme en exil, et de la minutieuse préparation psychologique de son assassin, pendant plusieurs années, par un agent des services secrets soviétiques. La narration, qui fait alterner les chapitres sur l’exilé et sur le tueur, est aussi fascinante qu’un roman d’espionnage de John Le Carré. Les incertitudes et les rebondissements des derniers jours avant le meurtre, racontés presque heure par heure, sont pétrifiants.
Il s’agit pourtant d’une histoire vraie, largement connue, du moins dans ses grandes lignes : le meurtre au Mexique en 1940 sur ordre de Staline, de Lev Davidovitch Bronstein, plus connu sous le nom de Trotski, par Ramón Mercader, un jeune communiste fanatisé, sélectionné dans les rangs républicains pendant la Guerre d’Espagne et manipulé avec un cynisme absolu.
Que penser des deux protagonistes ? D’un côté, un homme vieillissant en exil, toujours ardent dans ses convictions, mais de plus en plus isolé, ce qui pourrait susciter la compassion ; en fait un fanatique obsessionnel, un idéologue illuminé, obnubilé par sa rancœur contre Staline, et qui avait montré quelques années plus tôt, à la tête de l’Etat Bolchevique et de l’Armée Rouge, sa capacité à sacrifier cruellement à sa cause des dizaines de milliers d’hommes. De l’autre côté, un jeune Catalan exalté, rêvant d’un paradis sans exploiteurs ni exploités, où règnerait l’égalité et la prospérité ; un homme disposant de réelles qualités, auquel on aura inoculé artificiellement la haine de Trotski, qui finira par perdre son libre arbitre et donc son âme ; quelques doutes au dernier moment ne le feront pas reculer. Le premier perdra la vie, l’autre passera le reste de la sienne à rechercher son âme perdue, mais aucun des deux ne mérite la compassion.
S’il en est un qui mérite la compassion, c’est Iván, un écrivain cubain raté né en 1949, un homme malchanceux qui raconte son histoire personnelle en contrepoint de celle de la traque de Trotski par Ramón Mercader. Iván avait rencontré l’homme qui aimait les chiens, venu finir ses jours à Cuba à la fin des années soixante-dix. C’est ainsi qu’il avait entendu parler de Ramón Mercader. Une belle occasion d’écrire un roman, qu’Iván ne saisira pas, du moins sur le moment. Il ne se sentait pas le courage d’aller à l’encontre des « vérités » décrétées par l’URSS, que le régime castriste soutenait sans réserve, après en avoir adopté le modèle économique et l’orthodoxie politique fondée sur l’impossibilité d’une contestation. Très peu de Cubains savaient d’ailleurs qui avait été Trotski et il était presque impossible de se documenter sur lui. L’île vivait alors des subsides de l’URSS, jusqu’à ce que son effondrement plonge Iván et tous les Cubains dans la misère la plus sombre. Toute la vie d’Iván aura été une chute morale et matérielle, marquée essentiellement par la peur.
La peur ! Pour Iván, c’est l’un des piliers sur lesquels reposent les régimes totalitaires. Une peur de tous les instants, qui s’abat sur le peuple, ainsi astreint à l’obéissance muette, sur les dirigeants, exposés à tout moment à la disgrâce sans raison, et sur Staline lui-même, un assassin qui voyait partout des assassins à faire assassiner. L’autre pilier de ces régimes est le mensonge, la capacité cynique à proférer et diffuser des contre-vérités – on dirait aujourd’hui des fake news – pour instiller la haine.
Comment le système soviétique et ses copies ont perverti une grande utopie ! Quand le ciel aura fini de s’écrouler sur le malheureux Iván, c’est la leçon que tirera son ami Daniel, un autre écrivain cubain, dans lequel on peut voir un double de l’auteur, Leonardo Padura, que l’on reconnaît à sa passion pour le base-ball et que l’on suit dans sa Pontiac modèle 1954.
Leonardo Padura n’a jamais quitté Cuba, son pays, où il vit presque anonymement, ignoré par les médias nationaux assujettis au régime, alors que ses œuvres sont traduites et diffusées en dix langues de par le monde. Cet homme qui n’a pas peur est un immense romancier.
DIFFICILE ooooo J’AI AIME PASSIONNEMENT

/image%2F1426270%2F20230713%2Fob_43d236_img-0417.jpeg)