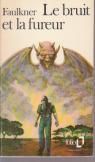Octobre 2016,
 Impossible de lire Petit pays sans y investir sa sensibilité personnelle. J’ai pourtant essayé. Sachant que ce roman s’inscrivait dans le contexte des abominations commises au Rwanda en 1994, j’étais bien décidé à le lire en me tenant à distance, afin de me protéger de pages dont je prévoyais qu’elles pourraient être insoutenables.
Impossible de lire Petit pays sans y investir sa sensibilité personnelle. J’ai pourtant essayé. Sachant que ce roman s’inscrivait dans le contexte des abominations commises au Rwanda en 1994, j’étais bien décidé à le lire en me tenant à distance, afin de me protéger de pages dont je prévoyais qu’elles pourraient être insoutenables.
Et je me suis fait avoir ! Car le début du livre est délicieux, drôle, touchant ; l’écriture est fluide, limpide, lumineuse. J’ai baissé la garde, comme anesthésié. La toile de fond dramatique des événements n’est apparue que peu à peu. A l’instar des personnages du roman, c’est de façon presque insensible que je me suis trouvé embarqué dans une spirale d’émotions « en tour d’écrou », pour paraphraser Henry James : appréhension, inquiétude, incrédulité, effarement, accablement, ... et par moment l’horreur !
Au début de l’histoire dont il est le narrateur, Gaby n’a pas encore onze ans. Il vit alors à Bujumbura, capitale du Burundi. Papa, un entrepreneur français, a les cheveux clairs et les yeux verts. Maman est native du Rwanda, l’état voisin. Elle est très belle : « une beauté svelte, à la peau noire ébène »... Un physique de Tutsi, l’une des ethnies peuplant cette région de l’Afrique des Grands Lacs.
Les Tutsi constituent une caste dominante au Burundi. Au Rwanda, ce sont les Hutu, plus nombreux, qui sont au pouvoir. Hutu et Tutsi se haïssent. Ils se haïssent tellement que les meurtres inter ethniques sont fréquents et massifs. Jusqu’au génocide de 1994, où en trois mois, près d’un million de Tutsi seront victimes de l'acharnement des Hutu à les exterminer. S’en suivront, dans la région, des représailles à n’en plus finir. Des événements tragiques qui ont fait la une de nos journaux, d’autant que les forces d'interposition françaises s’étaient retrouvées quelque peu en porte-à-faux…
Les événements et leur enchaînement en 1993 et 1994, Gaby les découvrira au fil des mois au travers des témoignages de ses proches. Terrifiant ! Un rude apprentissage de la réalité, auquel il cherchera à résister avec candeur. Il sera finalement contraint de s’y soumettre, comme tous les petits garçons qui se façonnent dans les épreuves qu’ils traversent... ainsi que dans les bêtises où les copains les entraînent...
Comme bêtise entre garçons, il y a le « t’es pas cap’... ». Comme de sauter du grand plongeoir ; classique pour un gamin challengé par les copains. Mais s’il faut lancer un Zippo allumé sur une voiture arrosée d’essence, c’est ... autre chose !... Sortie brutale du cocon de l’enfance, de l'innocence, de la neutralité insouciante ! Même les enfants sont amenés à choisir leur camp. De gré ou de force.
Jusqu'à alors, Gaby avait vécu dans une sorte de jardin d’Eden, une impasse tranquille, arborée et fleurie d’un beau quartier de Bujumbura. Des villas habitées par des familles d’occidentaux expatriés et de notables africains. Gaby et ses copains y vivaient en marge de l’existence rude de la population africaine. L’impasse : un symbole de havre de paix fermé aux passages non désirés.
Lors de la guerre civile, tout va changer. Gaby verra son impasse profanée, sa famille fracturée, son paradis perdu. La spontanéité des Burundais, qui les amenait à se laisser aller sans retenue à la gaîté, à l’amitié, à la fête, les fera basculer sans plus de retenue vers la colère, la haine et la violence.
Vingt ans plus tard, Gaby est resté marqué par le symbole de l’impasse. C’est ainsi qu’il qualifie son pays d'accueil, la France : une immense impasse, une sorte d’oasis tranquille où les bruits et les fureurs du monde ne parviennent qu’assourdis.
Perdure l’envie de retourner à Bujumbura ! L'occasion se présente : récupérer un ensemble de livres légués par une vieille voisine qui l’avait initié à la littérature. Départ en forme de quête, à la recherche de l’impasse, des parents, des amis, de l’enfance perdue...
Et une dernière scène qui m’a bouleversé aux larmes : dans le fond d’un bar, une vieille femme, qui n’a plus toute sa raison, évoque en radotant des taches au sol qui ne partent pas... Des propos incompréhensibles pour ceux qui l’écoutent – et qui d'ailleurs ne l’écoutent pas ! – mais qui m’ont replongé dans l’une des pages les plus poignantes du livre... Gaby repartira-t-il de sitôt ?
Gaël Faye, l’auteur, est un brillant poète et rappeur – qui me fait penser à Stromae. Il a le même âge que Gaby. Comme lui, il est né au Burundi, d’un Français et d’une Rwandaise. Il précise qu’il n’a pas vécu ce qu’a traversé Gaby. Il aurait pu. Il l’a imaginé dans Petit pays, son premier roman, magnifiquement écrit. Un témoignage sur le vif. De l'émotion à l’état pur.
Vous pouvez acheter directement ce livre en cliquant sur ce lien

/image%2F1426270%2F20230713%2Fob_43d236_img-0417.jpeg)