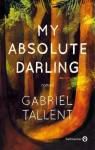Mai 2018,
Comme ce roman est sombre ! Il prend place dans le Donegal, une région isolée à l’extrême nord de l’Irlande. Un paysage de prés boueux et de tourbières, une mer agitée couleur d’étain, un ciel souvent lourd de menaces, un climat froid et pluvieux. Les événements se produisent pendant la seconde guerre mondiale. Si l’on n’y perçoit guère l’écho des combats, l’on en ressent les restrictions dans la vie de tous les jours.
Dans La neige noire et son univers de fin du monde régi par des traditions immémoriales, vivent des fermiers pauvres, arriérés. Des rustauds, des taiseux, dont on ne peut déchiffrer les pensées. Absorbés par les nécessités de leur survie quotidienne, peut-être même ne pensent-ils pas.
Un soir, vers la fin de l’hiver, un incendie ravage l’étable d’une ferme. La toiture et la charpente de la vieille bâtisse s’effondrent dans une explosion de matières calcinées, dont les cendres retombent lentement comme des flocons de neige noire. Quarante trois vaches périssent carbonisées ou asphyxiées sous les yeux horrifiés et impuissants de leur propriétaire, Barnabas Kane, de sa femme Eskra et de leur fils Billy, quatorze ans. Essayant d’intervenir avec son ouvrier Matthew Peoples, Barnabas lui-même manque d’y laisser sa peau... Le gros Matty aura eu moins de chance.
L’incendie s’est-il déclenché accidentellement ou résulte-t-il d’un acte de malveillance ? Comment vont réagir les assurances ? Quelle est la part de responsabilité de Barnabas dans la mort du pauvre Matthew ? Quoi qu’il en soit, il en faudrait plus pour que Barnabas s’abandonne au désespoir. Les dents serrées, il a bien l’intention de montrer à tous ceux qui l’observent depuis leurs fermes voisines, guettant sa chute, qu’aucune embûche ne l’empêchera de rebâtir son outil de travail.
Dès les premières pages et tout au long du livre, pendant que le quotidien suit son cours, on apprend, qu’autrefois jeune orphelin laissé pour compte, Barnabas avait émigré à New York, où il avait travaillé comme charpentier sur la construction de gratte-ciel, un métier acrobatique et dangereux qui lui avait façonné le caractère et permis d’amasser un petit pécule. C’est là-bas qu’il avait épousé Eskra, une Américaine d’origine irlandaise, et que Billy était né. Revenu au pays avec une mentalité de pionnier, Barnabas a acheté des terres, une ferme et des bovins. En quelques années, il est devenu un éleveur relativement prospère. De quoi susciter jalousie et ressentiment, d’autant plus qu’Eskra, apicultrice, cultivée, pianiste, n’a pas vraiment le profil d’une paysanne du coin.
Mais peut-être les sinistres événements qui frapperont Barnabas et sa famille sont-ils le produit d’une rancœur plus profonde, d’une suite d’erreurs de jugement et de décisions maladroites d’un homme aveuglé par une ambition obsessionnelle et une obstination cynique, qui l’entraîneront dans une descente aux enfers prévisible. Jusqu’à l’Enfer lui-même, dont j’ai cru voir dans les dernières pages s’ouvrir la porte, où un fantôme n’ayant rien d’un Commandeur, mais qui n’avait pas voulu mourir, prenait la main d’un homme à l’agonie, n’ayant rien d’un séducteur, mais qui ne savait pas se repentir.
Une interprétation personnelle que chacun est libre de contester, de même que chacun peut ressentir à sa manière le symbole du massacre des abeilles d’Eskra par un gang de guêpes criminelles.
La neige noire est le deuxième roman de Paul Lynch, un Irlandais natif du Donegal. Son écriture est empreinte d’un lyrisme sombre, en harmonie avec le climat tourmenté et la beauté sauvage des lieux. Son vocabulaire, foisonnant, évoque à la perfection les images qu’il transcrit.
Le rythme de la narration est très lent. L’ossature du texte se présente à l’état presque brut, comme de la poésie. D’un paragraphe à l’autre, on passe sans indication d’un moment à un autre, d’un personnage à un autre. Les dialogues sont directement insérés dans la narration. A chacun d’imaginer les connexions.
Un effet littéraire pleinement réussi, mais pas forcément accessible à tous les lecteurs.
TRES DIFFICILE oooo J’AI AIME BEAUCOUP

/image%2F1426270%2F20230713%2Fob_43d236_img-0417.jpeg)